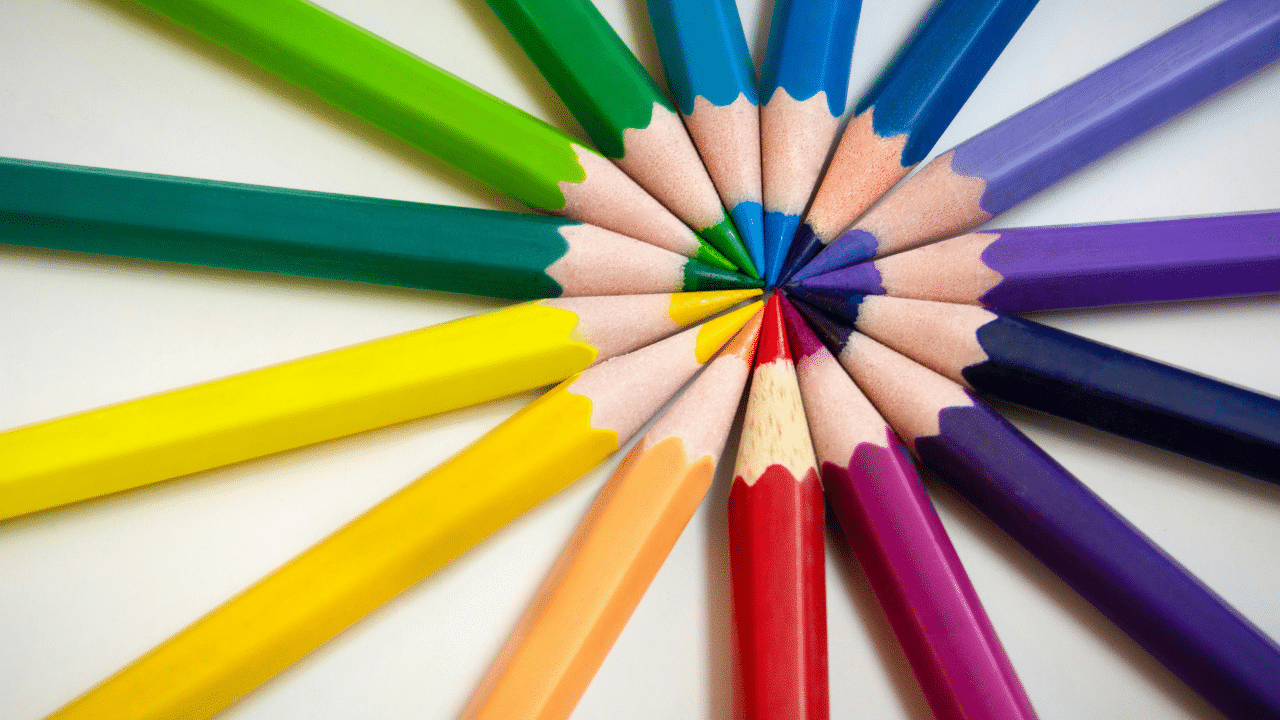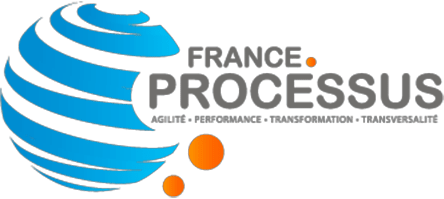Audit interne et contrôle interne : quelle différence ? Ces deux notions sont souvent confondues, et il nous est fréquemment demandé de préciser la différence entre les deux. Alors que le contrôle interne agit au quotidien pour cadrer et sécuriser les activités, l’audit interne intervient en second temps pour constater les écarts entre ce qui devrait être fait et ce qui l’est vraiment, tout en proposant des pistes d’amélioration. Il s’agit donc bien de deux notions distinctes, mais complémentaires.
Notre outil de gestion des risques peut faciliter la mise en place d’un contrôle interne au sein de vos entreprises. Il vous permettra d’identifier vos risques, d’impliquer vos agents dans la gestion des risques et de prioriser et maîtriser vos risques, notamment grâce à notre matrice d’évaluation des risques. Notre module de cartographie des processus pourra aussi vous venir en aide pour modéliser l’ensemble de vos processus et ainsi contribuer au contrôle interne.
En complément, pour réaliser vos audits internes, notre solution d’amélioration continue, PYX4 Improver, est l’outil idéal pour suivre vos dysfonctionnements, faciliter les remontées terrain de vos collaborateurs et mettre en place des plans d’action adaptés.

Définition du contrôle interne
Le contrôle interne est un ensemble de dispositifs qu’une organisation peut mettre en place pour maîtriser ses risques et atteindre ses objectifs.
C’est un outil qui cadre l’organisation, qui l’empêche de commettre des erreurs, des fraudes ou des dérives sur des exigences réglementaires.
Le contrôle interne est intégré dans plusieurs processus du quotidien :
- processus modélisés
- procédures
- validations
- principes de séparation des tâches
- contrôles de cohérence
- autres contrôles (financiers par exemple)
Exemples concrets d’application du contrôle interne
- Validation d’une dépense par deux niveaux hiérarchiques
- Vérification automatique des droits d’accès dans un logiciel
- Procédure formalisée de gestion des réclamations clients
👉 Le contrôle interne se situe véritablement au niveau opérationnel.
Définition de l’audit interne
L’audit interne est une fonction indépendante chargée d’évaluer l’efficacité du contrôle interne, entre autres.
Son objectif est d’identifier les dysfonctionnements, les points d’amélioration et les écarts mais aussi de soulever les points forts déjà mis en place dans l’entreprise.
Il est souvent mal perçu, car les collaborateurs pensent qu’il est là pour pointer les problèmes ou blâmer les collaborateurs. Or, il accompagne l’amélioration continue, permet de repérer les failles, les corriger et d’adapter le contrôle interne existant.
L’auditeur n’est pas là pour faire le travail à la place de l’opérationnel, mais pour observer, analyser et formuler des recommandations.
Exemples d’application de l’audit interne
- Évaluer si la séparation des tâches en comptabilité, liée aux dépenses et leur validation, est bien respectée et efficace.
- Vérifier que la gestion des risques SI est réellement appliquée et testée, sans qu’aucune action dans un logiciel ne soit faite par un profil n’ayant pas le droit de l’exécuter.
- Auditer le processus “Satisfaction client” pour identifier des points faibles structurels, en proposant des recommandations et améliorations à appliquer.
👉 L’audit interne apporte un regard extérieur et vérifie si le cadre existe bien et est appliqué correctement, tout en donnant des pistes d’amélioration.
| Caractéristique | Contrôle interne | Audit interne |
| Temporalité | Continu, intégré aux missions opérationnelles quotidiennes | Périodique, planifié ou ponctuel |
| Acteurs | Opérationnels et managers | Auditeurs internes indépendants |
| Méthodologie | Intégré au fonctionnement de l’organisation, mais peut être appliqué selon des méthodes existantes comme la méthode COSO | Se base sur des normes et standards (ISO…) |
| Rôle | Prévenir et sécuriser | Évaluer et conseiller |
| Finalité | Assurer conformité et fiabilité | Constater les écarts et proposer des pistes d’amélioration |
Le modèle des 3 lignes de défenses
Le modèle des trois lignes de défense donne un cadre de gestion des risques utilisé par les organisations pour clarifier les rôles et responsabilités en matière de maîtrise des risques, contrôle interne et audit.
Pour comprendre comment le contrôle interne et l’audit interne s’articulent, on peut s’appuyer sur ce modèle. Il aide à structurer la responsabilité de chacun dans le fonctionnement d’une entreprise.
- Première ligne de défense : les opérationnels
Les managers et collaborateurs mettent en œuvre les activités et gèrent les risques au quotidien.
- Deuxième ligne de défense : les fonctions de supervision
Les services comme la Qualité, la Conformité, les Ressources Humaines ou le Contrôle de gestion accompagnent, encadrent, conseillent et surveillent les pratiques.
- Troisième ligne de défense : l’audit interne
L’audit interne intervient en toute indépendance, pour évaluer objectivement l’efficacité des deux premières lignes, mais aussi celle de la gouvernance et de la stratégie.
À travers ce modèle, on s’aperçoit bien que l’audit interne complète le contrôle interne sans jamais s’y substituer.
Comment le contrôle interne et l’audit interne se complètent-ils ?
Sans contrôle interne, une organisation est exposée à des risques non maîtrisés. Et sans audit interne, le dispositif de contrôle interne peut être inefficace ou mal appliqué sans que la Direction en ait conscience.
Ensemble, ils forment donc un levier essentiel de gouvernance et de confiance auprès des parties prenantes en interne comme en externe (clients, actionnaires, régulateurs).
Même si le contrôle interne n’est pas encore tout à fait mature, il existe toujours un minimum de pratiques permettant de mesurer et de limiter les risques : c’est ce qui constitue le référentiel de contrôle interne. En revanche, un audit interne ne peut pas auditer un cadre non mis en place. C’est pourquoi, il faut d’abord prioriser la mise en place du contrôle interne puis vérifier son efficacité et sa bonne application grâce à l’audit interne.
C’est en combinant contrôle interne et audit interne que l’organisation renforce sa performance, sa résilience et la confiance de ses parties prenantes.
Image à la Une : Léa L – Unsplash